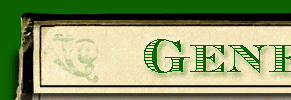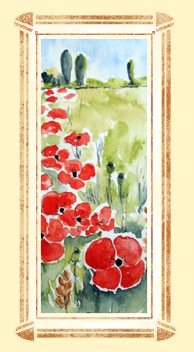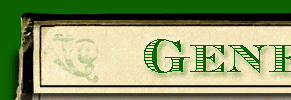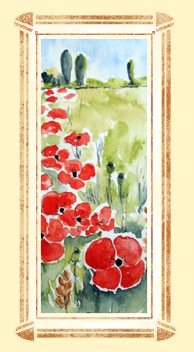|
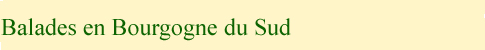
Imaginez 72 km d’une bande de bitume bien lisse qui traverse la campagne au milieu des arbres et des champs. Imaginez une piste fermée aux fous du volant loin du bruit des agglomérations. Imaginez enfin que cette voie puisse être agrémentée de haltes touristiques, de petites gares pittoresques… Ne rêvez plus, cet endroit existe en France, c’est la Voie verte qui traverse le département de la Saône-et-Loire du Nord au Sud. Se balader, musarder, s’arrêter, découvrir, repartir… Quand on veut, comme on veut, pour quelques heures, la Bourgogne en a fait une réalité. Et pour roder nos vélos encore flambants neufs, il n’y a pas mieux. Mais qui dit Bourgogne dit aussi vin (et vice versa). Or, on ne peut parler des vins de Bourgogne sans évoquer la Roche de Solutré, et sa sœur à Vergisson, qui domine un charmant petit village de sa silhouette préhistorique. Et la meilleure manière de découvrir ce spectaculaire escarpement calcaire s’élevant à 495 mètres d'altitude, très connu pour avoir été foulé par tonton, notre ancien président de la République, c’est évidemment la marche à pied. En quelques textes, voici le récit de nos balades en Bourgogne du Sud que nous avons réalisé du 5 au 13 mai 2008, sur un parcours de 440 km.


Lundi 5 mai : Après avoir fait le plein des réservoirs, nous voilà partis dans le sens inverse de notre première sortie, plein nord. Malgré une circulation loin d'être négligeable, le passage du tunnel sous Fourvière s’est avéré finalement un bon choix pour rejoindre tranquillement Villefranche-sur-Saône. Ordinairement, il est de bonne coutume d’éviter la fastidieuse traversée de cette ville, c’est-à-dire la rue Nationale, ou plutôt la grande artère commerçante, celle aux maisons colorées avec, au centre, la collégiale Notre-Dame-des-Marais. Nous aurions pu nous en mordre les doigts. Finalement cela a été très facile… Et rapide. De plus, le spectacle qu’offrait cette longue rue, du haut de nos sièges, a été un vrai régale pour les yeux. La route s’étire à nouveau devant nous. Arrivés à Saint-Jean-d'Ardières, nous faisons une pause casse-croûte à deux pas de la Maison des Beaujolais. Cet arrêt, programmé par des ventres qui gargouillent, fut finalement une bonne chose. Au lieu d’aller droit au but, nous prenons la D 69 pour rejoindre Pizay, plus généralement connu pour son château, l'un des plus grands domaines de la région. En quelques tours de roues, nous arrivons à Villié-Morgon, un petit village niché au sein des coteaux du Beaujolais qui s'est imposé comme l'étape indispensable pour les amateurs de vin, de par sa situation sur la route des Beaujolais, au cœur des grands crus. La route monte ensuite régulièrement. Nous suivons la D 18 jusqu’au Truges pour prendre la D 26. Ici, le paysage est une immense sculpture de coteaux où la culture de la vigne joue un rôle prépondérant aux côtés de domaines. Le spectacle est grandiose et la vue splendide. Et dire qu’il n'y a pas de vendange mécanique, tout est fait à la main. Il n'y a pas à dire, nous découvrons une très belle route des vins dans le Beaujolais. Arrivée à la chapelle Saint-Roch, un petit arrêt photo s’impose. Des vignes à perte de vue. Malheureusement, la lumière n'est pas fantastique à cause de quelques nuages sur l'horizon. Le col de Durbize (543 mètres) passé, une longue descente nous amène à Juliénas. Cru impérial par son étymologie, Juliénas tiendrait son nom de Jules César. C’est le plus emblématique du Beaujolais. Il est réputé grâce aux articles du Canard Enchaîné qui lui rendait hommage dans la période de l'après-guerre. Nous poursuivons sur une petite route de campagne qui mène à Saint-Vérand, petit bourg au flanc d’une colline, entouré de vignobles, où nous rattrapons la D 31 qui conduit à Leynes. Cette charmante petite commune de Saône-et-Loire est à la frontière géologique de deux contrées viticoles de renommée mondiale : Le Beaujolais et la Bourgogne. C’est aussi un de ces vieux villages du mâconnais qui a vécu sous l'influence des moines de Tournus : Le blason de l'abbaye, représentant la crosse et le glaive, est partout présent dans le village pour qui sait regarder les vieilles pierres, seul matériau de construction de l'église et des maisons de la place du village. Le visiteur pressé ne manquera pas de faire un bref arrêt pour aller observer les platanes au centre du village. Leur particularité : De nombreuses pointes de branches sont soudées entre elles. La cerise sur le gâteau, un décor étonnant renforcé par le contraste des couleurs environnantes. Quelques kilomètres plus loin, surgit devant nous, figé au milieu des vignes, la Roche de Solutré. Le petit village viticole de Solutré-Pouilly, blotti à ses pieds, se distingue à peine du raffinement du décor. Remarquable dès son approche par sa composition paysagère insolite, la Roche de Solutré n’en est que plus belle lorsque sa sœur jumelle, la Roche de Vergisson, tout à coté et tout aussi belle, pointe son nez de calcaire. Il est temps de couper le moteur. Nous nous garons au bout d’un parking où se trouve ce qu’on appelle la « voie romaine », sur un replat, juste avant le chemin descendant au hameau des Chancerons. Cet endroit vit ses derniers moments puisqu’il va être aménagé en parking de délestage (200 places) lors des périodes de très forte fréquentation. Les travaux du parking principal au lieudit « En Carras » sont d’ailleurs bien avancés. Quand à l’ancien parking, qui était un point visuel marquant et disgracieux, il a déjà été effacé du paysage. C’est dire que nous avons de la chance de pouvoir profiter encore pleinement de cette terrasse naturelle, si l’on peut dire, avec, en premier plan, le fameux rocher de Solutré et sa voisine, la roche de Vergisson.
Aussitôt arrivés, aussitôt partis… A pied pour une balade. Cette petite marche nous emmènera en une demi-heure au pied de l’éperon de calcaire, après avoir passé aux abords du village. Juste pour un moment de détente et quelques photos souvenir.
Mardi 6 mai : Le temps est idéal pour la marche. Du soleil mais pas de grosse chaleur. Nous partons à la découverte des deux roches par une boucle improvisée mais qui, finalement, était bien balisée. Evidemment, il n’était pas question de ne pas faire l’ascension magnifiques falaises calcaires. Une balade au caractère un peu montagnard ? Pas du tout mais la longueur peut en rebuter plus d’un. Nous partons donc en direction de la bourgade de Vergisson, en suivant l’ancienne voie romaine. Au Hameau de Chancerons, à une cinquante de mètres à l’est des dernières maisons, à proximité d’une croisée de chemins, se dresse un bloc en grès, de forme phallique, de près de 3 mètres de hauteur. Faux ou vrai menhir, borne ou simple pierre érodée. D’après la Société d’Histoire Naturelle du Creusot, ce n’est qu’une pierre debout. Alors pourquoi elle est classée monument historique depuis 1992. Nous avons cherché un peu partout mais nous n’avons pas trouvé de réponse à cette question. D'un point de vue plus terre-à-terre, le quartier est très agréable à parcourir. Descente, montée, nos pas sont rythmés sur une cadence métronomique imperturbable. Après avoir traversé le village de Vergisson, nous continuons à grimper vers la roche homonyme. L'accès jusqu'au sommet est très bien indiqué. L'intérêt de cette partie du circuit réside dans la variété du tracé : Chemin, sentier, pierres... et d'une végétation changeante : Vignoble de Pouilly-Fuissé, forêt de châtaigniers, bois de sapins en bruyères sur la crête, site de buis et de steppes sur la roche. La roche de Vergisson est moins connue que sa voisine la roche de Solutré et est restée plus sauvage. Mais au faîte de la falaise ocre et rouge, la perspective et, à notre goût, plus ouverte et plus variée que celle de sa sœur, peut-être grâce à sa vue unique sur une partie de la Vallée du Beaujolais. Au dessus de nos têtes et du vignoble chasse un faucon crécerelle que nous reconnaissons à son vol en Saint-Esprit si caractéristique. Après l’avoir observé un moment, nous dévalons (côté Est) le coteau Vergissonnais sur un large chemin en bordure d’un milieu naturel préservé ici par des chèvres. La pente est douce et herbeuse. On parvient rapidement au parking (cote 396) d’accès du Vergisson, en bout d’une étroite route goudronnée. Ici, le balisage (bande jaune, accompagné parfois d’un point bleu) semble se perdre un peu. Peu importe. Nous tirons tout droit pour descendre un chemin de vignes avec, en ligne de mire, le lycée viticole et agronomique de Davayé, facilement reconnaissable par son allure moderne. Plus bas, arrivés sur un large chemin (cote 324), nous tournons à main gauche pour retrouver, sur la droite, le balisage que nous avons sans doute « zappé » plus haut. Du lycée, nous rejoignons la place de l’église où nous faisons une petite pause bien méritée après deux heures de marche.
Nous continuons notre boucle en longeant le cimetière afin de rejoindre le lavoir de Chaponière, situé en bordure du hameau du même nom. Nous entamons l’ascension de la célèbre roche de Solutré par ses douces pentes bien que le départ soit raide. Là, le chemin est bétonné. On comprend mieux pourquoi ce revêtement au passage de deux tracteurs sur châssis enjambeur (sans doute des « Bobard ») qui nous saluent chaleureusement. Le balisage jaune, discret, guide nos pas à travers les vignes réveillées avant de rejoindre les pentes sommitales, occupées par une végétation méridionale de pelouses sèches envahies par le buis. Plus haut, les nombreux sentiers qui couraient à travers les buis ont été remplacés par un large chemin borné. Et c’est par ce chemin que nous atteignons le sommet aux roches polies par des millions de pieds. Nous n’aurons pas l’occasion de voir les chevaux Konik Polski, d’origine polonaise, proches cousins des chevaux préhistoriques, réimplantés sur le site de la roche de Solutré pour participer à la conservation des pelouses semi-naturelles (pâturage) et, ainsi, au maintien de paysages ouverts.
Après un tour d’horizon sur la campagne environnante, nous quittons ce monde par un large sentier, avec vue sur Vergisson, qui nous conduit aux pieds de la falaise de Solutré. Puis, après avoir coupé une vigne, nous enquillons l’ancienne voir romaine en sens inverse de notre départ. Notre tour, d'une roche à l'autre, ces deux sœurs sorties des âges du jurassique, se termine après trois heures de marche et un dénivelé somme toute raisonnable.
Du sommet, nous aurions pu revenir sur nos pas et descendre rejoindre le musée départemental de préhistoire, enterré au pied de la roche, pour visiter les collections d'un des plus riches gisements préhistoriques d'Europe. Nous avons préféré une autre descente, car plus naturelle, et aussi, il faut bien l’avouer, nous préférons avant tout le tourisme champêtre où l'histoire est inscrite dans le paysage. Ne serait-ce que quelques pierres car, comme le dit si bien Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, « un tas de pierres cesse d'être un tas de pierres dès qu'un seul homme le contemple avec en lui l'image d'une cathédrale ».
Après un bon petit repas dans le camping-car, nous repartons requinqués pour quelques kilomètres de route. En deux virages, le profil de sphinx a disparu de notre regard. Le trajet est avalé en rien de temps, ponctué de quelques grandes courbes à travers les vignobles bougonnais. Nous voici à Charnay-lès-Mâcon. Le cœur de ville bat au rythme de la vie citadine mais à l’ouest de l’autoroute, de vastes espaces naturels témoignent de son attachement à son environnement pour rester « une ville à la campagne ». Nous rejoignons le point de départ de la Voie verte qui n’est autre que l'ancienne gare de Charnay-Condemine. Après leur fermeture en 1970, l’ancienne voie de chemin de fer Mâcon-Cluny et la gare de Charnay-Condemine ont retrouvé une nouvelle vie. Rétrocédées à la ville par la SNCF, ces infrastructures ont été réhabilitées pour devenir un espace à vocation touristique, de loisirs, de détente et de découverte. L’ancienne gare, restaurée, a été convertie en syndicat d’initiative en mai 1998. Nous délaissons le parking pour celui de la cave coopérative, légèrement en surplomb, bien à l’écart de toute circulation, notamment des va-et-vient des voitures des clients, afin de bénéficier du charme et du calme de ces lieux… Avec un soleil digne du mois d'août. Inutile de dire que nous profité de notre temps pour acheter une bonne bouteille de vin, un Mâcon-Charnay blanc de 2006, et flâner sur cette espace d’un autre temps. Rien ne manque (ou presque) : Le « Café de la Gare », la villa des Moineaux… Dés notre arrivée, nous sommes impressionnés par le nombre de personnes qui viennent se balader à pied, en vélo ou en rollers, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, rapides ou lents, expérimentés ou débutants.
Mercredi 7 mai : Les VTT sont sortis de la soute, préparés, l’odomètre journalier est réinitialisé... Et ce fut l'heure de notre première sortie en direction du petit village de Sologny. Au départ de Charnay, les sept premiers kilomètres sont en ligne droite et en montée faible et régulière. Ensuite, on rencontre plusieurs raidillons mais brefs, agrémentés de charmants passages. Cette partie de la Voie verte serpente à travers le Val Lamartinien. Dans la première partie, elle offre de très beaux paysages, dominés, au loin, par les roches de Solutré, Vergisson et du Mont de Pouilly, trois des dix grands sites classés de Bourgogne. Elle traverse le vignoble et les villages du Mâconnais, où le poète Lamartine a laissé de nombreux souvenirs (il a passé le début de sa vie à Milly). Signalons aussi que la voie passe devant plusieurs caves viticoles, notamment celle de Prissé qui met à disposition des camping-caristes une aire de service gratuite. D’ailleurs, la halle marchandise abrite la cave coopérative. Malgré le temps, la gare de Prissé a gardé sa marquise métallique.
L’arrivé au parking de la Voie verte à Sologny ne nous enthousiasme pas trop (ligne du TGV à proximité), nous descendons donc la rue centrale du village pour repérer un petit coin tranquille pour passer la nuit. Ça tombe bien, en deux tours de roues, nous trouvons un petit terre-plein en retrait de la D 17, juste avant un pont qui permet d’accéder au lieudit des Furtins. A noter que sur une carte postale ancienne représentant ce pont de chemin de fer, ce lieu avait pour nom « La Croix Blanche ».
Le retour est sans surprise et se passe exactement comme à l’aller, avec toutefois un petit arrêt photo au rond-point, à la croisée de la D 17 et de la D 89, qui symbolise la célèbre roche de Solutré et sa jumelle, la roche de Vergisson. Arrivés à notre point de départ, le compteur affiche 24 km.
Jeudi 8 mai : C’est jour férié... et chômé qui plus est. Nul doute que nous croiserons beaucoup de monde aujourd’hui .Le beau temps est toujours de la partie, l'élan est donné, appareil photo aux poings, l'excursion peut commencer. L’asphalte de la Voie verte trace notre parcours. D’abord une longue montée douce sous une frondaison rafraîchissante desquels on apprécie le calme des lieux. Non loin de là, on découvre Berzé-le-Châtel, le château le plus imposant du Mâconnais, dressé sur son éperon dominant la Voie verte. Epousant le paysage, il affiche un air débonnaire malgré ses treize tours et ses trois enceintes fermées sur un jardin en terrasse. Tout ça dans un décor de carte postale. Sur notre passage, nous trouvons une ancienne maisonnette de passage à niveau. Celui-ci est, d'après sa plaque, le 151ème depuis Moulins, origine de la ligne. La voie verte nous réserve ensuite une surprise : Un tunnel nous rappelle soudain que nous jouons toujours au petit train. Désaffecté après l’arrêt de l’activité ferroviaire, l'ouvrage de 1602 mètres de long avait servi de champignonnière. Il offre la particularité d’accueillir des populations de chauves-souris en période hivernale et aussi une colonie de mise bas en période estivale. Ayant horreur de la lumière et du bruit pendant leur repos souterrain, elles sont séparées de nous par un faux-plafonds. Le tunnel Bois Clair, situé au cœur de la colline qui sépare le Clunisois du Mâconnais, est une traversée peu ordinaire qui a un vrai goût d’aventure. Pour ajouter aux sensations, il fait un peu frisquet : 11 degrés au thermomètre. C’est le plus long tunnel d’Europe aménagé en Voie Verte : 6 à 8 minutes à vélo sont nécessaires pour le franchir. Il est bien éclairé et sécurisé, mais très humide : La « chaussée » est détrempée par le ruissellement s’échappant des fissures du granit, glissante à souhait pour ceux qui cherchent les extrêmes. La cheminée centrale du tunnel, d'une hauteur de 86 mètres, qui permettait l'évacuation des fumées, est toujours là. Encore faut-il lever la tête pour la trouver. A la sortie du tunnel, une montée raide, puis la piste longe l’autoroute sur une cinquantaine de mètres sur une voie étroite, puis une descente très raide où il est impératif de freiner et de maîtriser sa vitesse. Puis, jusqu’à Cluny, à hauteur de l’ancienne gare transformée en halte-relai, la voie est encore vallonné mais techniquement pas spécialement difficile. S'impose alors une sortie de la Voie verte en direction de la célèbre abbaye bénédictine, qui fut l'une des plus importantes de la chrétienté (Saint-Pierre-de-Rome avait autrefois une rivale). Flâner à travers les rues permet de basculer dans le passé et d'imaginer l'époque où Cluny fut la lumière de l'Occident. Nous faisons une courte pause et reprenons le chemin du retour tout en faisant quelques pauses. Rouler pendant des kilomètres au milieu de la nature, sans voitures, sur un bitume en très bon état, quel régal… Même on n'est pas des foudres de guerre dans les grimpettes bien raides. De retour à Sologny, le compteur affiche 25 km.
En milieu d’après-midi, nous reprenons la route pour Cluny où nous trouvons une place à proximité du parking de la Voie verte. Si le cadre de l’ancienne gare est agréable, les lieux ne sont pas spécialement propices pour passer la nuit. La halle marchandise, qui tombe malheureusement en désuétude, est couvert de tags… Et le passage d’une ronde de police n’est certainement pas un hasard. Sans hésitation, nous préférons rejoindre directement notre prochaine étape, la gare de Cormatin, à 13 km au nord de Cluny. Pour le camping-car, cette ancienne gare, contrairement aux autres, n’a pas tout ce qu’il faut pour plaire, mais ses quelques possibilités de stationnement restent un atout de tout premier choix pour découvrir la portion de Voie verte entre Saint-Gengoux-le-National et Cluny.
Vendredi 9 mai : Le soleil est encore plus fort qu’hier. Cela promet encore une belle journée. L’itinéraire débute tranquillement, si ce n’est la proximité de la D 981, pour atteindre la halte de Taizé, un village universellement connu pour ses rencontres œcuméniques internationales, et rejoindre la gare de Massily, en apparence endormie, presqu'en plein bois. Le bleu de ses volets et de ses portes… Et hop, une autre petite photo souvenir pour immortaliser l’instant. La Voie verte se poursuit assez plate et traverse des pâturages où paissent les blanches charolaises. De l'herbe, partout de l'herbe, ébouriffée de boutons d'or, de pâquerettes… Une cadole (abri de vignes) nous salue à notre passage puis, plus loin, après le bois de Pain-Parraud, c’est la chapelle de Cotte. A l’approche du pôle hippique de Cluny, le décor est moins pittoresque, tout est relatif, mais c'est tout de même un plaisir de pédaler sous le soleil au mois de mai… Et puis la gare est toute proche, et le centre ville est à quelques tours de roues pour prendre un moment de détente à la terrasse d’un café. Les platanes du quai central offrent quelques moments de fraîcheurs avant le retour. Fortement dosée en chlorophylle, notre balade se clôture à la gare de Cormatin, un peu comme une amusante remontée dans le temps, jusqu’à la belle époque. Les mordus de vélos en tout genre ont remplacé les voyageurs mais son « Hôtel des voyageurs » est toujours là, plein de vie, grâce à la communauté monastique basée à Taizé. Le compteur journalier indique 29 km.
L’après-midi est consacrée à une promenade à pied aux environs immédiats afin de prendre le temps de découvrir les lieux qui nous entourent. Nous passons devant le Musée du Poilu, ouvert depuis quelques semaines seulement, qui a remplacé le Musée du Vélo, unique en son genre, fermé depuis la fin de l'année dernière « en raison d'un manque d'aide et de reconnaissance » (dixit son site Internet). Plus loin, au milieu du bocage, quelques belles charolaises broutent l’herbe appétissante des pâturages. Notre flânerie en lisière d’un univers poétique et apaisant laisse une impression de voyage en milieu rurale d’autrefois. Nos pas enjambent la petite Grosne avec, au bout, Cormatin qui étire sa grande rue en bordure d’un parc à la française où se niche son château, paré de douves, abritant un somptueux décor peint à l’époque des Mousquetaires et du Cardinal de Richelieu qui y séjourna. Au centre du village, une ancienne manufacture accueille de nombreux artisans qui vendent leurs produits dans une vaste salle d'exposition permanente. Le cadre est agréable, mais il est dommage d'y trouver essentiellement des productions provenant de régions autres que la Bourgogne, alors que, par exemple, ses produits du terroir, avec des stars emblématiques, font sa renommée. Notre circuit se termine à la gare de Cormatin où nous passons une nouvelle nuit.
Samedi 10 mai : Aujourd’hui, nous partons à l’opposé, toujours sous une météo ensoleillée, toujours pour le plaisir de pédaler, toujours avec la joie de découvrir kilomètre après kilomètre d’autres paysages attrayants… Et relier Saint-Gengoux-le-National. Nous cheminons le long de la Grosne à travers une verte vallée, tantôt sur une rive, tantôt sur l’autre. La petite halte de Malay permet de rompre agréablement avec la linéarité de la Voie verte, d’autant plus que la petite commune possède deux églises romanes classées monuments historiques. L'église Saint-Martin d'Ougy du 11ème siècle et au 12ème siècle, puis l'église «Notre Dame de Malay » du 19ème siècle. Plus loin, de subtiles teintes vertes dans un océan de fleurs jaunes, aussi loin que l’on peut regarder, apparues subitement, et, bien sûr, plein de soleil, nous oblige un court arrêt. Une pause photo s'impose car la lumière est superbe. De même que la ferme de Messeau, avec ses bâtiments imposants et sa cadole démesurée. Bref, un p'tit moment de bonheur pour les yeux. En deux coups de pédales (ou presque), nous arrivons à Saint-Gengoux-le-National, ou plutôt à son ancienne gare. Là, le décor est planté. L'ambiance de cette gare et son cadre magnifique nous plonge un siècle en arrière. Sa grue hydraulique, usuellement appelée « manche à eau » (cette grue orientable servait à l'alimentation en eau des tenders des locomotives à vapeur), même si elle est tombée en totale obsolescence, fait toujours partie du paysage ferroviaire. Lorsqu’on est petit-fils et arrière-petit-fils de cheminot, on est forcément plus attentif aux petits riens qui évoquent les trains à vapeur de jadis. Nous reprenons le chemin du retour, la tête pleine d’images, ravis de ce parcours qui, comme ceux des jours précédents, a été à la fois très intéressant et sympathique, même si le kilométrage est moindre (17 km).
Vers midi, nous quittons Cormatin pour rejoindre l’aire de service de Saint-Gengoux-le-National. La suite de la Voie verte nous attend et, de plus, nous devons nous ravitailler en eau potable, vidanger les eaux usées… Enfin, la totale quoi ! Nous ne serons pas seul, loin sans faut d’ailleurs. Déjà, les habitués sont installés. Même bien disposés, face à l’unique borne d’électricité, évidemment avec un câble électrique, branché au secteur, reliant leur maison qui roule. Aux frais de la princesse ou plus exactement aux frais de la mairie. Bien pratique pour cuire les grillades (histoire vrai). Nul doute que cela ne vas pas plaire à tout le monde mais, à notre arrivée, une petite discussion avec le maire laisse à penser que certaines choses devraient changer au vu de la situation actuelle. Il faut dire que l’électricité (gratuite) de cette aire de service est le poste de frais le plus onéreux. Bref, le maire n’était pas venu pour cela mais pour récupérer, avec quelques conseillers municipaux, une « machine à goutte (1) » entreposée dans l’ancien bâtiment ferroviaire jouxtant l’aire de service. Histoire de créer l’événement, ce jour même, aux « Portes ouvertes » de la Cave des Vignerons de Buxy.
Si le patrimoine architectural du village de Cormatin ne nous avait pas particulièrement passionné, celui de Saint-Gengoux-le-National est tout autre. Nichée dans un repli de la Côte chalonnaise, la petite capitale du canton, construite en pente, enferme dans ses anciens remparts une cité médiévale riche en souvenirs. A commencer par ses rues qui affichent la couleur médiévale par des noms évocateurs : Rue Pavée d'Andouilles, rue du Moulin-à-Cheval, rue des Fossés, place du Pilori… L'ambiance méridionale de ses fontaines et de son avenue principale, son lavoir qui recueille les eaux de la fontaine de Jouvence, ses vieilles demeures se dévoilent au fil de la flânerie. La plus singulière est certainement la « Maison de bois », une habitation à architecture bourguignonne à pans de bois du second quart du 15ème siècle, dont les fondations datent de 1410 et les ouvertures sont de style gothique flamboyant. Autre curiosité du lieu : Le clocher de l’église, typiquement roman, octogonal et à trois étages, relié à un beffroi par une passerelle. La visite aurait pu durer des heures tant elle est riche en surprises mais nous préférons honorer l’invitation du maire aux « Portes ouvertes » de la Cave des Vignerons de Buxy. L’accueil est plutôt sympathique même la démarche n’est pas dénuée de tout intérêt commercial. Nous avons eu droit à une dégustation gratuite et, chacun, un verre à vin aux motifs de la cave. Evidemment, nous ne repartons pas les mains vides. Le vin est sans conteste l’ambassadeur le plus célèbre de la Bourgogne, il aurait été dommage de ne pas profiter de l'occasion pour acheter une bouteille ou deux.
Surprise à notre retour à l’aire de service. En lieu et place d’un camping-car qui se trouvait à côté du nôtre, deux autres camping-cars, disposés tête-bête, tout cela avec aisance, avaient pris sa place. Rien d’extraordinaire en soi, si ce n’est que nous étions coincé, côté porte d’entrée, dans un espace étroit. De plus, des blaireaux pas très aimables. Sans parole, pas même un bonjour. Pas même un sourire. Finalement, au bout de quelques heures, sans que nous disions quoique ce soit, ils se déplacèrent sur un emplacement qui était déjà libre à leurs arrivées. Des habitués du coin, semblent-t-ils. A croire qu’ici, le sans-gêne est de mise. Comme ceux qui utilisent les lavabos des toilettes publiques pour faire leur « petite vaisselle ». Evidemment, laver de grosses casseroles dans un petit évier, c’est plus salissant er moins pratique. Allez ! On arrête d’être mauvaise langue car il y a quand même plus de camping-caristes souriants, civiques et agréables à vivre que de bande d'irréductibles, pas toujours gaulois du reste.
Dimanche 11 mai : Le temps est toujours au beau fixe. Le ciel est complètement dégagé. Nous avons vraiment de la chance car, d'après ce qu'on nous a dit, le Sud ne serait pas si gâté. Aujourd’hui, on repart pour une bonne trentaine de bornes. Nous prenons plein nord, direction Buxy. Et toujours une piste comme on n'ose pas en rêver tellement elle est bien, un parcours particulièrement bien choisi, un paysage bucolique et des environnements variés. En passant devant l’abri de quai de la gare, nous apercevons la nouvelle animation du coin, appelée « la Rosalie », voiturette à pédales composée d’une remorque, qui se loue selon des circuits proposés par l’office de tourisme pour découvrir les richesses touristiques alentours. Au vue de ce que nous avons rencontré depuis notre départ de Charnay-lès-Mâcon, landau-poussette, trottinette, roller, ski-roues, vélo couché, cyclorameur, remorque avec bac ou biplace derrière un vélo, tandem, biporteur, triporteur, véloporteur, etc., et même une brouette (de plus, poussée par un cheminot en retraite), plus rien ne nous étonne. Le visuel de la sortie de Saint-Gengoux-le-National est remarquable. Peut-être juste un effet optique dû au gabarit du pont à double voie qui barre l’horizon. Puis c'est la traversée de la D 49, avec le PN n° 26. Un coup de chapeau, au passage, aux Bourguignons. Ici, et ailleurs, les voitures s’arrêtent pour nous laisser passer, sans klaxonner, même si on hésite un moment pour traverser. La Voie verte passe au pied des vignes qui tour à tour s’exposent ou se cachent mais ne sont jamais bien loin. On a l’impression de rouler en petit train et on aimerait entendre le sifflet des trains d’autrefois. On remarque que la plateforme est plus large, pour la double voie. A droite, les dernières vignes de l'extrémité de la côte chalonnaise. Nous arrivons au hameau d'Etiveau. La maisonnette du passage à niveau a servi de halte pour les voyageurs après la fermeture de la bifurcation en direction de Montchanin, le bâtiment d'origine étant sans doute trop éloigné du hameau. Dans le paysage, on voit bien la séparation des voies. Tout droit en direction de Chalon-sur-Saône, et à gauche, au milieu des vignes, la ligne de Montchanin qui attaquait une bonne rampe en courbe avant d’arriver au viaduc de Crainseny, un ouvrage construit pour franchir une petite vallée. Nous n’avons pas pris la peine d’y consacrer du temps et nous le regrettons bien sûr. A Saint-Boil, la maisonnette du passage à niveau est toujours là, avec sa guérite pour la manœuvre des barrières. Le bâtiment voyageur a subit quelques modifications (aujourd’hui, c’est une habitation privée), mais a conservé sa marquise. Seul l'abri de quai a disparu. Une petite construction nous fait un clin d’œil. Du temps de la Compagnie du PLM (Paris-Lyon-Méditerranée), on appelait cet endroit l'édicule d'aisance. Tiens, une ferme. C'est en réalité la halle marchandise de la gare de Saint-Boil qui abrite une exploitation agricole. C'est la seule halle de la ligne encore en usage, mais pour une autre utilisation. Quelques kilomètres plus loin, nous atteignons la halte de Jully-lès-Buxy. Le bâtiment a été rallongé, et a malheureusement perdu ses plaques. Et voilà que le décor change car la plateforme de la voie est en tranchée. Buxy est à présent à portée de roue, et en y arrivant on passe sur le passage supérieur de la D 18. Il n’y pas de doute, la gare Buxynoise est plus belle que du temps de l'exploitation de la ligne. Ceci n'est qu'un avis personnel. Il faut dire qu’elle a été restaurée depuis l'ouverture de la Voie verte, et abrite l'office du tourisme de Buxy. De plus, un passage couvert a été ajouté entre la marquise du bâtiment voyageur et l'abri du quai. A l’office de tourisme, on se renseigne pour éventuellement stationner aux abords immédiats de la Voie verte. S’il n’y a pas de problème particulier pour séjourner derrière la gare, la proximité de la D 977 et des travaux en cours du côté de la maison de retraite ne nous incite pas à installer notre camp de base pour la nuit. Après une courte pause, nous repartons à l'assaut de l’asphalte pour rejoindre Saint-Gengoux-le-National.
Arrivés au camping-car, nous prenons le temps de faire le plein d’énergie, de converser avec des personnes que nous avons rencontré la veille. Malgré cela, on ne traîne pas trop. Tout ça pour dire que demain c’est jour férié, et les places risquent d'être chèrement disputées à Givry, notre prochaine étape. Et c’est vrai qu’en arrivant, il a fallu attendre quelques temps pour disposer d'une place pour garer notre camping-car parce que, s’il y a bien une aire communale, au départ de la Voie verte, sur le parking de l'ancienne gare, le stationnement est libre d’accès à tous véhicule à moteur. On ne se plaint pas, on reste calme, on prend son mal en patience. Nous avons même pris le temps de discuter (plus exactement baragouiner) avec un couple anglais, apparemment de Londres. Finalement, les places se libèrent rapidement. En fin d’après-midi, tout en visitant le village, nous flânons dans les rues afin d'y repérer une boulangerie où nous irons nous approvisionner le lendemain. Pour l’anecdote, avant les élections municipales de 2008, Givry était connue pour ses vins. On dit même que le vin de Givry était le préféré du roi Henri IV. Aujourd’hui, cette petite bourgade de 3 600 habitants, est également connue pour son second tour insolite. Car, ici, pour être élu... Il faut être vieux. En effet, au soir du 16 mars dernier, les électeurs givrotins rassemblés à la mairie ont vécu un suspens mémorable. Après plusieurs recomptages et vérifications, il fallut se rendre à l'évidence : 968 voix pour la liste de droite, 968 voix pour la liste de gauche. Du jamais vu. Branle-bas de combat : On potasse le code électoral, on appelle la préfecture. Une seule chose à faire : Additionner les âges des 27 candidats de chaque liste. La liste de gauche, attaquée pour sa jeunesse et son inexpérience, gagne au bénéfice de l'âge. Du coup, c’est la première fois depuis un siècle que les électeurs de Givry envoient une liste de gauche à la mairie.
Lundi 12 mai : Le soleil est encore dominateur aujourd'hui malgré que la veille, en fin de journée, de gros nuages menaçaient d'éclater plus au Sud. La direction est toute tracée pour cette nouvelle sortie en VTT : Buxy. Soit un parcours aller-retour d’un peu plus d’une vingtaine de kilomètres. Sur la droite, la halle marchandises de la gare de Givry est toujours là. Elle est restée longtemps en très mauvais état mais, en 2006, avec l'envolée des prix de l'immobilier et des terrains, elle a trouvé un nouveau souffle en se transformant en un superbe loft. A la sortie de la gare, on trouve encore le bâtiment du PN 53, puis du PN 52. Par contre, il ne reste rien du PN 51, à la traversée de la D 104. Et très peu de choses du PN 50, à côté de Maison Dieu, avant la scierie. L'angle de mur de la maisonnette a toutefois été conservé car il supporte un repère de nivellement. La Maison Dieu, c’est tout bonnement un lieudit ou se dressent les vestiges d’un établissement hospitalier dont la fondation est antérieure au 13ème siècle. L’exploitation agricole actuelle abrite trois monuments historiques : La chapelle romane Notre-Dame-de-Pitié (on peut encore admirer le clocher, l’abside et un pan de mur de la nef), un puits et une pierre tombale du 14ème siècle. De la Voie verte, cet ensemble architectural est très étonnant même s'il existe un manque d'équilibre entre l’ancien et le récent. Sur place, la photo s’impose d’elle-même. Juste pour le plaisir. Et maintenant, une fois passé sous le pont de la route express, la N 80, nous glissons en direction de Saint-Désert. Après avoir franchi plusieurs passages à niveau, dont il devient difficile de suivre la numérotation, nous voici en vue de la gare de Saint-Désert. La gare est maintenant une habitation. Elle a conservé ses plaques et l'abri de quai est toujours intact, contrairement à celui de Givry qui a disparu. A l'emplacement de l'ancienne halle marchandise, on trouve depuis quelques années, un restaurant, abrité dans une ancienne voiture voyageur. Le nom est évocateur : Le Wagon. On parvient devant la maisonnette du PN de la petite route menant à Granges puis, plus loin, c’est les restes d’une ancienne cabane servant d'abri aux ouvriers de l'entretien des voies, un pont en pierre avant d'arriver à Buxy, et une borne avec un repère de nivellement, marquant l'emplacement du PN 44. Et c'est l'arrivée à la gare de Buxy. Sa halle qui a été rasée pour laisser la place à une maison de retraite. La création d’une piste cyclable reliant le bourg à la Voie verte nous permet de rejoindre aisément le cœur de cette petite agglomération typique qui a su garder le charme d'une vieille cité médiéval. Pittoresques à souhait, les rues des vieux quartiers, bordées de maisons anciennes, invitent à la flânerie. Elle sera courte mais suffisante pour apprécier le charme souriant et le grand calme qu’elles dégagent. Se poser le temps d’un café, à la terrasse d’une brasserie, est également une manière de vivre ces lieux chargés d’histoire. Après cette bonne pause nous rentrons tranquillement.
En milieu de l’après-midi, nous décidons de profiter du beau temps pour visiter Givry. Nous passons à travers les places et les rues, là où nos pas nous mènent, là où nos yeux sont séduits par les charmes de cette petite ville. Rien de comparable avec ce que l'on a apprécié à Buxy mais Givry à la particularité de posséder le plus vieux registre paroissial de France : Un livret de 84 feuillets, tenu par les vicaires du lieu, de 1303 à 1357. C'est dans ce registre qu'ils relevèrent la liste des mariés de 1336 à 1357 et celle des sépultures, de février 1334 à novembre 1348, soit en pleine épidémie de la grande « peste noire », qui déferla alors sur le royaume de France et en décima la population. Quand on est généalogiste depuis de nombreuses années, on ne peut qu’apprécier ce coin de Bourgogne. Côté patrimoine, Givry n’est pas en reste. Sa mairie figure parmi les plus beaux hôtels de ville de France. Sa halle ronde, située au centre de la ville, et sa Fontaine aux Dauphins sont également des éléments architecturaux remarquables. Mais la construction qui surprend le plus est l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Par sa taille (sa flèche pyramidale culmine à 47 mètres du sol), la stéréotomie savante de ses voûtes, la rude modernité de ses élévations. Elle apparaît comme un bâtiment peu commun dans cette région où prédomine le style roman.
Givry est un petit paradis pour la vigne. N’est-il pas plaisant de lire sur certaines étiquettes « vin préféré du roi Henri IV » ? Au hasard de nos pas, nous pénétrons dans la cour d’une exploitation viticole, histoire d’acheter une bonne bouteille de Bourgogne pour la suite de la soirée. Ici, comme sans doute ailleurs, acheter sans déguster avant, cela ne se fait pas. On nous offre une dégustation en règle dont les fameux pinots noirs, un cépage rouge et noble de Bourgogne. L'ambiance est tranquille et reposante et le maître des lieux est très sympathique et serviable. De plus, le cadre du domaine est charmant. C’est un fief cité au milieu du 18ème siècle par l'historien de la Bourgogne, l'abbé Claude Courtépée (1721-1781). Le cellier indique la fonction viticole du domaine et son portail rappelle l'influence d'Emiland Gauthier, architecte de l'église, de la mairie et du lavoir de Givry. Cellier et colombier sont d’ailleurs des éléments protégés par les monuments historiques. Mais le clou de la visite reste la cave en pierre sèche du 17ème siècle, construite en aérien et non pas enterrée. Ses deux demi-voûtes ogivales, de plus de 7 mètres de hauteur, sont des plus remarquables. Au fond, un foudre imposant (21.5 hectolitres) surveille de sa hauteur (3.60 mètres) un nombre impressionnant de pièces (228 litres) mis en rang d'oignon sur plusieurs alignements. Il n'y a pas à dire, le propriétaire a le sens de l'accueil et une foule de belles histoires à partager. D’autant que nous étions seuls à partager ce moment privilégié.
Mardi 13 mai : Depuis quelques mois, Givry (à 9 km de Chalon-sur-Saône) n’est plus le point de départ le plus au nord de la Voie verte. Actuellement, il se trouve à Saint-Rémy, le long de l'école des Charreaux, et n'est pas très accessible car il manque encore la partie qui va rejoindre le centre ville en passant le long du futur hôpital après avoir traversé la rocade. Toute la zone est en travaux et il va falloir un certain temps pour que cela soit fonctionnel. Les touristes utilisateurs qui arrivent de Givry sont d'ailleurs bien ennuyés pour continuer leur route. Nous faisons fi de cette réalité. Nous enfourchons donc nos VTT pour constater par nous-mêmes si, oui ou non, l’accès au centre de Chalon-sur-Saône est maintenant possible. Des fois qu'entre-temps la boucle soit bouclée. Nous passons devant le bâtiment voyageur, reconverti en salle de judo, pour rejoindre la maisonnette du PN 54, avant l'entrée en gare de Givry. Après la traversée de la D 69, nous passons sous une belle frondaison d’un vert profond et une passerelle métallique, conçue à l'origine pour un usage agricole. Dommage que quelques tags commencent à défigurer ce petit coin de verdure. A moins que ce soit de l’art urbain et, là, nous n'avons rien compris. Au PN 56, dans la zone artisanale de Givry, le seul vestige restant est un angle en pierre de la maisonnette. La partie la plus intéressante du point de vue paysage commence à partir du Moulin Madame, un ancien manoir du 15ème siècle transformé en chambres d’hôtes. Les points les plus intéressants sont le pont sur l'Orbize, la plateforme de la piste en tranchée ou, encore, le passage supérieur qui mène à la ferme de la Brosse. Après, c'est un triste passage sous l'autoroute (nombreux tags) et l’ex PN 60 qui marque la fin. La réalité était donc à la hauteur de ce que nous savons en regardant les guides touristiques. Mais cette partie était à faire à partir du moment où on a décidé d’accomplir la totale, même si ce n’est pas la plus séduisante de la Voie verte. Le retour est sans surprise et se passe exactement comme à l’aller, avec les mêmes constats. Seul point positif, dans un futur proche, à l'un des croisements de route, on pourra bifurquer sur une voie cyclable qui rejoindra la voie qui suit le canal du Centre jusqu'à Chagny en passant par les bois de Marloup. Les premiers travaux seraient sur le point de commencer.
Notre escapade bourguignonne tire à sa fin. Mais avant de rentrer, nous souhaitons faire durer un peu le plaisir, de revivre un peu de ces si beaux moments. Et c’est la petite gare de Cormatin que nous avons choisi pour passer ces quelques instants. Nous roulons cool, sans nous presser. A Sercy, où prennent forme les premières collines des Monts du Chalonnais, nous faisons une pause photo que nous n’avons pu faire en remontant. Couleurs et lumières sont au rendez-vous. On pouvait mieux espérer. Au pied de la colline du Bourgeot, un magnifique et imposant château, dont le plus vieux témoignage que l’on retrouve dans l’architecture date du 12ème siècle, ne laisse pas indifférent. Il séduit même ceux qui ne sont pas des passionnés d'architecture car il surgit altier entre deux virages, entre lesquels s'étale un étang bordé d'arbres séculaires. Il se singularise par une haute tour circulaire surmontée d'un hourd. Cette galerie de bois est l'une des plus anciennes de France. Le château de Sercy fut une des clefs du Mâconnais avec Brancion, et était notamment chargé de défendre l’abbaye de Cluny. Avant de s’arrêter à la gare de Cormatin, nous passons à Salornay-sur-Guye, par la route de Cortevaix, pour donner un coup d’œil à l’aire de service située dans le camping municipal de la Clochette. Pas de chance, celui-ci n’ouvre que du 24 mai jusqu'au 7 septembre.
L’après-midi, ben ! Comme tous les camping-cariste : Un moment de farniente sur la terrasse de notre camping-car. Malgré tout, pour terminer celle-ci, comme s’il n’y en avait pas assez, un petit footing tranquille, histoire d’entretenir la machine.
Mercredi 14 mai : Adieu la Bourgogne… Bonjour la Drôme. A peine arrivés au bercail et, en deux temps, trois mouvements, le Genesis 34 est nettoyé de A à Z, près pour un nouveau départ. Le bilan de ces dix jours d’escapade en Bourgogne du Sud : 442 km sur la route, 160 km en vélo… Et un certain nombre de kilomètres à pied. Comme quoi, nul n’est besoin de faire des cent et des mille kilomètres pour voyager en camping-car. Comme quoi, la découverte et le dépaysement peut être à notre porte...

1 - L’alambic, qu’on appelait plus communément la distilleuse, et plus familièrement la machine à goutte, c’était l’événement au cœur de l’hiver, l’animation au centre du village. Transmissible de père en fils, le « privilège », institué par Napoléon en 1806, permettait à chaque récoltant de faire distiller 10 litres d’alcool pur (100°) par an, soit 20 litres d’eau de vie à 50° ou 14 litres à 70°. Selon Louis Pauwels, « il faut bien distinguer le bouilleur de cru du bouilleur d’eau-de-vie. Le premier (...) c’est lui qui fournit la matière première nécessaire à l’opération : Pommes et poires fermentées, moût, marc de raisin. Le second, le bouilleur, possède un alambic et procède à la distillation ». Nombreux jadis en Bourgogne, ces artisans travaillaient durant tout l’hiver où ils se louaient de ferme en ferme. Ils installaient leur « machine à goutte » sur la place des villages viticoles et, sous un contrôle plus ou moins tatillon de douaniers redoutés, transformaient le résidu conservé du pressage de la vendange, la « genne », en un alcool diversement apprécié suivant les palais : Le « marc » célèbre de Bourgogne.

|